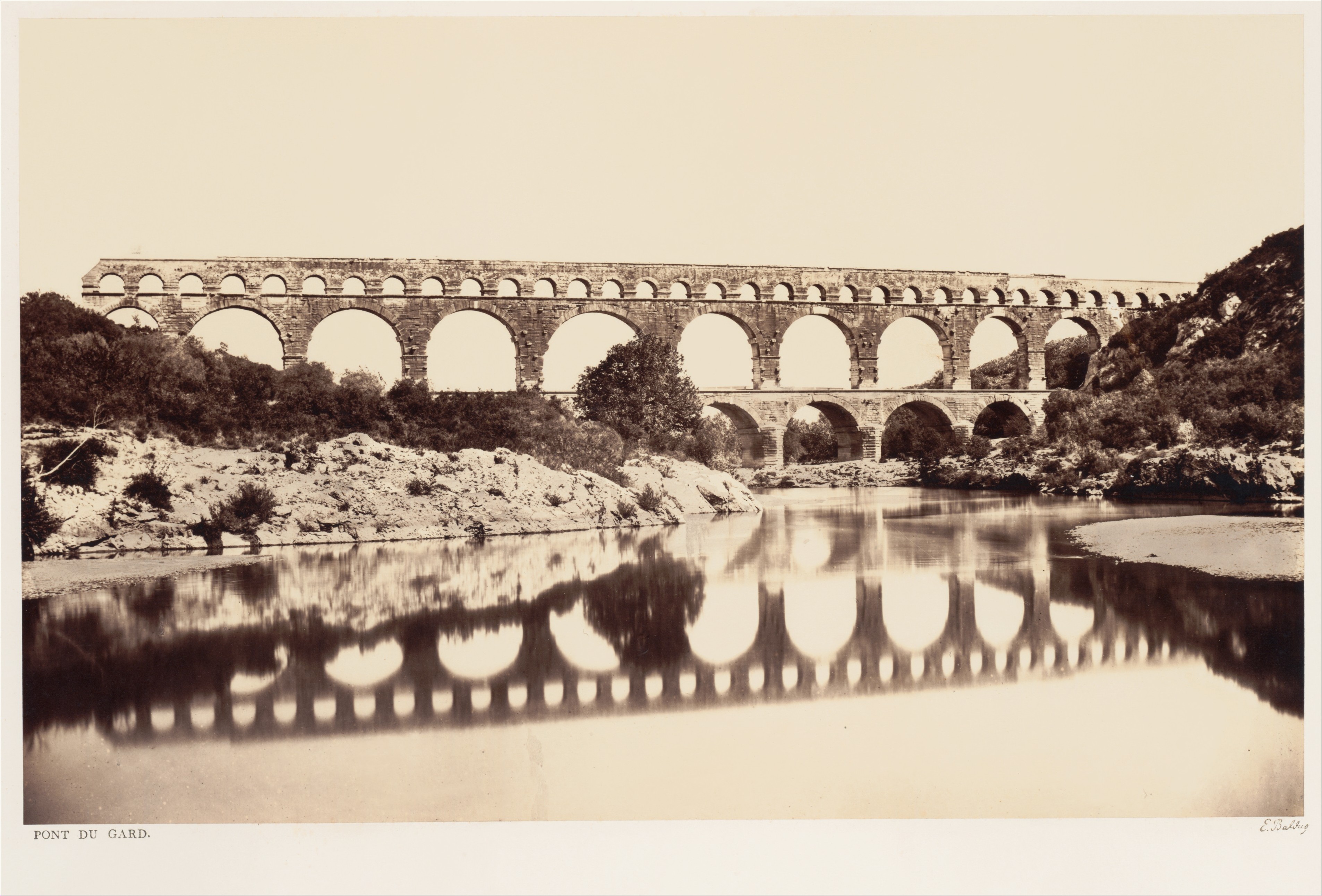 |
| © Metropolitan Museum of Art |
Rabelais, les arènes de Nîmes et le Pont du Gard / par Marcel Fabre.- Nîmes : Imprimerie Clavel et Chastanier Chastanier Fres et Alméras, succ., 1945.- pp. LVI-LXXIV ; 24 cm.
In : Mémoires de l'Académie de Nîmes (VIIe série - tome LII - Années 1939-1940-1941). - br. Cote PER 724 6 réserve ancienne.
En
dépit du manque total de documentation directe puisée dans les
archives, ce n’est pas se livrer à une conjecture hasardée que de parler
d’un séjour de Rabelais à Nîmes oui, si mieux on aime, d’une visite de
Rabelais aux monuments romains de Nîmes et sa région.
Les documents originaux faisant défaut, c’est à l’œuvre même du prestigieux écrivain qu’il faut s’adresser pour être renseigné et encore dans les cinq volumes de cette œuvre deux lignes seulement du Pantagruel nous mettent sur la voie. Deux petites lignes mais elles suffisent. Ce qu’elles nous apprennent ne permet pas le doute : Rabelais est venu à Nîmes et a parcouru ses environs. La fantaisie qui inspira ces deux lignes, si énorme qu’elle en fait ce qu’on Méridional appelle « une galéjade », loin de nous éloigner de la réalité de cette visite, en apporte la confirmation. Pour s’en convaincre, il n’est que de suivre le fils de Me Antoine Rabelais, avocat royal à Chinon, dans les hasards de son existence et ses voyages à travers le royaume de France qui devaient l’amener dans le Midi.
Des
premières années de Rabelais et de son adolescence on ignore tout. On a
dit qu’il avait étudié à l’abbaye bénédictine de Seuilly-en-Chinonais,
puis à celle de la Basmette dans les environs d’Angers. Affirmation
gratuite qui se fit jour au XVIIe siècle. La chose est cependant
vraisemblable, car l’abbaye de Seuilly est voisine de son lieu de
naissance, le clos de la Devinière près de Chinon, propriété de son père
et Angers était le berceau de sa mère maternelle. Ce qu’il fut et ce
qu’il fit en son âge viril nous est, par contre, mieux connu, grâce à
des documents authentiques. Environ sa vingt-sixième année, en 1520,
sachant de la scolastique tout ce que les programmes universitaires en
dispensaient, rompu à l’usage de la langue latine, il était moine
franciscain au couvent des Cordeliers de Fontenay-le-Comte, en
Bas-Poitou. On éprouve quelques surprise à voir ce jeune homme, qui va
se montrer avide de science, dans un ordre qui compta certes quelques
grands esprits, mais qui, dans l’ensemble, était composé de religieux
d’âme simple, frustes, aussi éloignés que possible du culte des
belles-lettres, ne soupçonnant rien du mouvement humaniste naissant,
pour la plupart illettrés ou peu s’en fallait, consacré uniquement à la
prière et à l’aumône. Et cependant, à tout bien considérer, pour qui –
et c’était le cas de Rabelais – voulait alors se consacrer à l’étude, il
n’était pas de meilleure retraite que le milieu monastique plus que
tout autre propice par la solitude qu’il imposait, à la réflexion et aux
fructueuses disciplines de l’esprit indispensables à tout labeur
intellectuel. Dans ce couvent du Puy-Saint-Martin, Rabelais eut la bonne
fortune de rencontrer un moine versé dans la métaphysique et la
philologie, l’orléanais Pierre Amy, de beaucoup son aîné, qui
l’intéressa à la langue grecque que l’on commençait à étudier et qu’il
avait apprise du professeur italien Jérôme Aleandre. Par son
intermédiaire, en 1521, il entra en correspondance avec Guillaume Budé,
le savant helléniste, pour lors secrétaire du Roi. A la faveur de
quelques sorties du couvent, il se lia avec un légiste de
Fontenay-le-Comte, l’avocat Tiraqueau, chez qui il rencontra un autre
jurisconsulte de grand renom. Amaury Bouchard, lieutenant général de la
sénéchaussée de Saintonge. Tous deux l’initièrent au droit romain et lui
dévoilèrent les arcanes de la procédure. En 1523 surgit un incident qui
jeta le trouble dans ses études, alors qu’il était fort occupé à
traduire en latin le second livre d’Hérodote. Erasme venait de publier
ses Commentaires sur le texte grec de l’Evangile de Saint-Luc,
s’autorisant de certaines particularités grammaticales et syntaxiques de
ce texte pour critiquer les enseignements de la faculté de Théologie.
La Sorbonne s’en alarma. Voyant dans le grec la langue des hérésiaques,
craignant que cette langue morte ressuscitée en se propageant ne
facilite la diffusion des doctrines luthériennes, elle en défendit
l’étude. Cette prohibition provoqua la confiscation des livres grecs
d’Amy et de Rabelais à leur plus grand désespoir. Pierre Amy n’accepta
pas la mesure. Il prit le large et se réfugia chez les bénédictins de
Saint-Mesmin, près d’Orléans. Quant à Rabelais, il patienta et réussit à
obtenir la restitution de ses livres. Mais comme le Grec était sa
passion et devait rester la passion de toute sa vie, pour assurer
l’avenir de ses études, il sollicita et obtint du pape Clément VII un
indult l’autorisant à quitter l’ordre des franciscains et à entrer au
couvent des Bénédictins de Maillezais, proche de Fontenay-le-Comte. Là
il se trouva dans un ordre où l’érudition et les belles-lettres étaient
en honneur. Il ne pouvait que s’en réjouir. Toutefois, il n’y fit qu’un
bref séjour. L’abbé du couvent était Jacques d’Estissac, évêque de
Maillezais, membre d’une puissante famille qui résidait en son prieuré
de Ligugé, à deux lieues au sud de Poitiers. Il s’intéressa à Rabelais,
frappé de sa vive intelligence et son amour de l’étude et l’attacha à sa
personne en qualité de secrétaire. Peut-être même – la chose paraît du
moins vraisemblable – en fit-il le précepteur de son jeune neveu, Louis
d’Estissac. Il l’emmena avec lui dans déplacements en Poitou, lui
témoignant une absolue confiance et lui octroyant large protection. A
Ligugé, Rabelais se lia avec deux familiers de la maison : le
rhétoriqueur et polygraphe Jehan Bouchet, procureur à Poitiers, et
l’abbé Ardillon, supérieur de l’abbaye voisine de Fontaine-le-Comte,
deux personnages de veste culture dont il reçut de profitables leçons.
Fréquemment il se rendait à Poitiers suivre les enseignements de la
faculté de Droit, une des plus florissantes du royaume, dont les
professeurs étaient de grand renom. Et voilà en 1527 on perd sa trace,
jusqu’en 1530 où on le retrouve
à Montpellier, s’inscrivant à la faculté de Médecine. Où passa-t-il ces
trois années ? Nous manquons ici de renseignements directs, mais tout
permet de penser que, sans cesse plus désireux de satisfaire la
curiosité de son esprit et son grand penchant de l’étude, il laissa là
sa robe de moine et, sous l’habit du prêtre séculier, il visita
plusieurs villes universitaires dans l’intention de conquérir un diplôme
qui le nantisse d’un gagne-pain. En effet, lorsqu’en 1532 il écrira son
Pantagruel, il se montra parfaitement au courant des
singularités topographiques, des dialectes, des mœurs et des coutumes de
Bourges, Orléans, de Paris, de la Rochelle, de Toulouse ; il citera les
noms de personnes résidant dans ces villes[1].
C’est donc qu’il les connaissait , ces villes, pour les avoir habitées.
Or, de 1530 à 1532 il n’a pu les visiter , car des documents
authentiques attestent que pendant cette période, il séjourna de façon
suivie à Montpellier et à Lyon. On peut donc considérer que ses
déplacements, à partir de 1527, durent le conduirent à Bourges, à
Orléans et à Paris puis le ramener à Poitiers d’où il partit pour
fréquenter les universités de Bordeaux et de Toulouse et gagner ensuite
Montpellier . C’est d’ailleurs là l’itinéraire qu’il fait suivre à son
héros Pantagruel dans son immortel roman qui, par endroits, traduit des
souvenirs personnels.
Écoutons son récit : « Ainsi croissait Pantagruel de jour en jour et
prouffitait à veue d’œil, dont son père s’esjouyssait par affection
naturelle et luy feist faire comme il était petit , une arbaleste pour
s’esbattre après les oysillons…, puis l’envoya à l’eschole pour
apprendre et passer son jeune eage. De fait, vint à Poictiers pour
estudier et proffita beaucoup… Lisant les belles chroniques de ses
ancetres, trouva que Geoffroy de Lusignan dict Geoffroy à la grand dent,
grand père du beau cousin de la sœur aisnée de la tante du gendre de
l’oncle de la bruz de sa belle-mère estait enterré à Mailleais, dont
print un jour campos pour le visiter comme homme de bien. Et parlant
Poictiers avecque aulcuns de ses compagnons, passèrent par Ligugé,
visitant le noble Ardillon, abbé, par Lusignan, par Sancay, par Celles,
par Colonges, par Fontenay-le-Comte, saluant le docte Tiraqueau, et de
là arrivèrent à Maillezays (où visita le sépulchre du dit Geoffroy à la
grand dent… Puys retourna non à Poictiers, mais voulut visiter les
aultres universitéz de France, dont, passant à la Rochelle se mist sur
mer et vint à Bourdeaulx…, de là vint à Thoulouse où aprint fort bien à
dancer et à jouer de l’espée à deux mains comme est l’usance des
escholiers de la dire université… Puis vint à Montpellier… »[2]
Ainsi
donc après avoir rompu définitivement avec la vie monastique et
fréquenté les université de Poitiers, de Bordeaux, et de Toulouse,
Rabelais arrivé à Montpellier, siège d’une très ancienne université,
fondée en 1289 par une bulle du pape Nicolas IV, dont la faculté de
médecine était une des plus renommée non seulement du royaume, mais de
l’Europe entière. Le 17 septembre 1530, il apposa sa signature sur le
registre matricule de cette illustre école après avoir prêté le serment
d’usage d’observer scrupuleusement les règlements imposés par les
statuts. Le professeur Jean Schyron fut son parrain. Six semaines après,
le jury d’examen, présidé par le même Schyron, lui conférait le grade
de bachelier en médecine. Les règlements imposaient à tout bachelier
l’obligation de professer un cours de stage à la licence. Dans le sien,
Rabelais fit figure de novateur en interprétant les Aphorismes
d’Hippocrate et le Petit art médical de Galien, d’après le texte grec
original ce qui ne s’était jamais fait encore., ces traités n’ayant
jusqu’alors été commenté que d’après la vulgate latine. L’helléniste
fervent qu’il était donnait ainsi la mesure de sa science philologique.
Pour l’écouter, une nombreuse assistance se pressait dans la salle où il
enseignait. Il se donna sans réserve à la vie totale de l’étudiant :
studieux et docte comme pas eux, mais aussi le premier aux banquets, par
quoi il était coutume de célébrer les nombreuses fêtes qui
s’échelonnaient au cours de l’année scolaire. Aimant bonne chère et bons
vins, il ne voulait voir de la vie que ce qu’elle avait d’aimable, de
joyeux et de facile, alors qu’il recherchait délassement après l’étude.
Son tempérament était tel, et resta tel toute sa vie. Il fut le
boute-en-train des réjouissances carnavalesques, l’organisateur des
moralités et des farces dans lesquelles les escholiers se plaisaient à
se mettre en scène les médecins, ridiculisant les légistes guindés et
vantards, et les légistes se moquaient des médecins qui sentaient le
« clystère »[3].
Il pourrait bien avoir été l’auteur de l’une de ces farces : « la
morale comédie de celuy qui avait épousé une femme mute dont il donne,
dans son Tiers Livre, le canevas suivi de l’énumération des étudiants –
au nombre desquels il figure – qui jouèrent les divers rôles. »
Rabelais
séjourna à Montpellier quelques quinze mois jusqu’au printemps de 1532
on le trouve à Lyon. De Montpellier, il vint certainement à Nîmes. La
chose est courant dans le monde des étudiants. Volontiers il venaient
visiter les antiquités romaines de cette ville voisine, si nombreuses et
si bien conservées. Nous avons plusieurs exemples de ces visites, ne
seraient-ce que les récits laissés par les deux frères Platter, ces
jeunes gens originaires de Bâle, venus successivement, au XVIe siècle ,
étudier la médecine à Montpellier et qui, à plusieurs reprises, en
compagnie de camarades, se rendirent à Nîmes, dont chacun a laissé dans
son journal d’intéressantes descriptions. Rabelais était trop désireux
de s’instruire, trop curieux de tout ce qui touchait à l’antiquité, pour
avoir négligé ce voisinage et n’avoir pas, lui aussi, fait son
pèlerinage aux Arênes, à la Tour-Magne, à la Maison-Carrée et poussé
jusqu’au Pont-du-Gard. Et puis, le parcours de Montpellier à Nîmes, à
s’en rapporter au Journal de Thomas Platter, comportait certains
attraits gastronomiques qui n’étaient pas pour déplaire à Rabelais.
C’était d’abord près de Lunelvieil l’auberge de la Bégude Blanche qui
passait pour la meilleure du Languedoc, réputée pour ses perdrix et ses
chapons, et puis à Uchaud celle de la Couronne où il était de coutume de
s’arrêter pour déguster un excellent vin clairet.
Si
Rabelais ne vint pas tout exprès à Nîmes pour voir ses monuments
antiques, il passa certainement par Nîmes et s’y arrêta pour les
visiter, lorsqu’à la fin de l’année 1531 ou au commencement de 1532, il
se rendit à Lyon. Pour aller dans cette ville en quittant Montpellier,
il n’y avait pas d’autre route que celle qui, par Nîmes, rejoignait la
vallée du Rhône. C’est bien celle qu’il fait suivre à Pantagruel, allant
de Montpellier à Valence par Nîmes et Avignon.
Au
cours de ses voyages, Rabelais avait eu plusieurs occasions de voir des
monuments romaines. A les observer, il s’était retrempé dans cette
civilisation disparue qu’il sentait revivre à travers ses lectures et
ses études de l’ancienne linguistique gréco-romaine. A Saintes, où,
durant son temps de « moinage » à l’abbaye franciscaine de
Fontenay-le-Comte, il se rendait chez le Président Amaury Bouchard,
n’avait-il pas eu ample vision de vestiges romaines avec l’amphithéâtre,
l’Arc de triomphe de Germanicus, les acqueducs et le Capitole. A
Poitiers, quand il allait deviser
avec Jehan Bouchet, n’avait-il pas vu les Arênes ? Et à Bordeaux, alors
qu’il musardait dans cette ville dont la Facultée [sic] délaissée lui
laissait nombreux loisirs, n’avait-il pas rencontré sur ses pas cet
autre amphithéâtre bâti par l’empereur Gallien, que les vieux parchemins
dénommaient aussi « les Arênes » , auprès duquel se voyaient les ruines
imposantes du palais qu’avait habité l’empereur, un majestueux ensemble
parlant à l’imagination de quiconque, comme lui, vivait dans le culte
des humanités renaissantes ?
De
Montpellier, Rabelais vint donc visiter Nîmes, où il passa, allant de
Montpellier à Lyon. Il vit les Arênes et le Pont-du-Gard, admirant,
comme cela se devait, ces colossales épaves de la civilisation
gallo-romaine. Il en conserva un tel souvenir que ce furent les seules
constructions qu’il jugea dignes, nous allons le voir, d’être attribuées
à son gigantesque héros Pantagruel. Dans les premiers mois de 1532, il
arriva à Lyon, un centre commercial français de premier ordre, où se
donnait rendez-vous le monde du négoce européen aux jours des quatre
grandes foires qui s’y tenaient pour l’Epiphanie, le Dimanche de
Quasimodo, le 2 août et le 3 novembre. Célèbres foires, d’une durée de
deux semaines, dont profitait la littérature, car les
imprimeurs-libraires, si nombreux dans la ville, choisissaient des dates
où affluaient tant d’étrangers, pour publier les livres nouveaux. Les
premières manifestations de l’activité de Rabelais à son arrivée à Lyon
furent d’ordre exclusivement littéraire. Dès le mois de Juin 1532 il fit
paraître chez le Maître typographe Sébastien Gryphe, une édition des Lettres médicales du médecin Ferrarais Jean Manardi. A la foire d’Août il publia, chez le même, les Aphorismes
d’Hippocrate. Le premier novembre 1532 marqua une date importante dans
la vie de Rabelais : il fut admis, comme médecin, au Grand Hôte-Dieu de
Lyon et, coup sur coup, à l’occasion de la Toussaint, parurent deux
ouvrages de lui.
Sébastien
Gryphe publia son Testament de Cuspidius et la Vente de Culita, texte
et commentaire de deux documents juridiques latins, dont on parlait
alors beaucoup dans le monde des juristes et que l’on reconnut plus tard
comme apocryphes, frabriqués vers la fin du Xve siècle par l’italien
Pomponius Laetus. En même temps paraissait,, chez Claude Nourry, autre
libraire lyonnais : « les horribles et espovantables faictz et
prouesses du très renommé Pantagruel, roy des Dipsodes, fils du grand
géant Gargantua, composez nouvellement par maistre Alcofrybas Nasier .»
C’était de ce pseudonyme, anagramme de son nom, que François Rabelais
avait signé cet ouvrage facétieux, rempli de « folastries », dans lequel
il donnait libre cours à sa verve débordante. Dans ce livre, inspiré
par la lecture du livre anonyme « Les grandes et inestimables chroniques du grant et énorme géant Gargantua »
paru quelques mois avant et qui l’avant tant diverti, Rabelais, en main
endroit, laissait apparaître, sous une forme drolatique, les
manifestations de sa vaste érudition.
En
lui s’alliaient, en effet, en pleine harmonie, malgré leur contraste,
la gravité du savant sûr de son savoir, et la gaillardise du rieur
impénitent laissant transparaître presque toujours, dans ses
plaisanteries les plus folles, quelque chose de son érudition qui les
élève au-dessus des bouffonneries vulgaires. Il se montra tel dans toute
son œuvre littéraire, justifiant le jugement que devait porter sur lui
Sainte-Beuve qui le considérait comme le seul, avant Ronsard, qui ait
été capable de la lecture largement prise à la source grecque ou latine,
ce qui se retrouve au milieu de ces bruyantes facéties, « à l’ampleur,
au naturel et à la richesse aisée de la fortune »[4]
Sa
devise, empruntée à Aristote, fut dès ce moment et demeura celle qu’il
devrait inscrire en épigraphe à son œuvre, ce surprenant témoignage de
son immense savoir et de son intarissable verve : « Rire est le propre
de l’homme », devise qu’il sut illustrer de maîtresse façon et qui
convenait si bien à son tempérament foncièrement optimiste. Car jamais
la morosité ne s’insinua dans ses ouvrages, qu’il écrivit non en pas en
bouffon, se complaisant dans la farce grossière parce qu’incapable
d’autre chose, mais bien en savant non dédaigneux de vie joyeuse et le
manifestant pour son plaisir et celui de ses lecteurs en même temps que
pour leur profit, en écrivant des livres amusants, dans lesquels
transparaît, dans un immense éclat de rire, une doctrine complète qui
touche à tout : philosophie, métaphysique, philologie, pédagogie,
politique, morale et sociologie.
Le succès de Pantagruel
fut grand. Le héros du livre, un bon et gaillard géant dont les
prouesses sont à l’échelle de sa taille, fils de Gargantua et de
Badebec, étudie à Poitiers, comme nous l’avons déjà vu, entreprend de là
une tournée dans les universités de Bordeaux, de Toulouse et de
Montpellier. Dans cette ville, il est bien près de Nîmes, il y vient et y
laisse, ainsi que dans les environs, une marque et non des moindres de
son passage. Lisons le récit de la prouesse. Elle est de première
grandeur : « Puis vint à Montpellier, où il trouva fort bon vins de
Mirevaulx et joyeuse compagnie, et se cuida mettre à estudier la
médecine ; mais il considéra que l’esta était fascheux par trop et
mélancolique et que les médecins sentoyent les clysères comme vieulx
diables. Pourant voulait estudier en loix ; mais voyant que là
n’estoient que troys teigneux et un pelé de légiste en dict lieu, s’en
parti et en chemin fist le Pont du Gard et l’Amphythéâtre de Nismes en
moyns de troys jours qu’il ne devint amoureux… » (Pantagruel chapitre V).
Et
voilà ! Pantagruel, dégoûté par la médecine et du droit, fuit
Montpellier, passe par Nimes et donne la juste mesure de ce qu’il
pouvait réaliser en construisant, en moins de trois heures, les Arênes,
et le Pont-du-Gard. C’est là sa première entreprise et, vraiment, pour
un coup d’essai, c’est bien un coup de maître. Très certainement
Rabelais s’est inspiré ici de la légende de Mélusine, la fée bâtisseuse,
dont il avait entendu parler en Poitou, à Lusignan, les prouesses
mirifiques. L’imagination populaire lui prêtait la puissance de bâtir,
la nuit, avec une extraordinaire rapidité, les plus grands monuments.
Rabelais avait voulu que Pantagruel la surpassât. Moins de trois heures
pour édifier, à Nimes, les Arênes et, à quelques lieues de là, le
Pont-du-Gard, évidemment c’était mieux.
Galéjade,
avons-nous dit, mais galéjade qui porte en elle son enseignement, car
elle traduit la vive impression faite sur Rabelais par les deux
magnifiques et grandioses monuments quand il les avait vus quelques mois
avant de publier son livre. Ces deux lignes facétieuses du Pantagruel
contiennent la preuve que Rabelais a vu les Arênes de Nimes et le
Pont-du-Gard. Elles font en effet partie de cette énumération des lieux
où il conduit son héros et qui ne sont autres que ceux ( nous l’avons
précisé) qu’il avait parcourus, où il avait séjourné dans ses voyages,
qui de Poitiers, l’avaient conduit à Lyon par Bordeaux, Toulouse, et
Montpellier. On se clairement compte que ce n’est pas par ouï dire qu’il
parle des Arênes et du Pont-du-Gard. Ce qu’il exprime, c’est une
opinion procédant de la vision directe de ces monuments quand il les
qualifie « d’œuvre plus divine qu’humaine ». S’exprimer de la sorte,
c’est les avoir vus et admirés, avoir été frappé par le génie qui
présida à leur conception, avoir été saisi par leur belle ordonnance
architecturale, la majesté et l’impression de beauté qui s’en dégage. Et
il s’y connaissait en architecture Me François Rabelais, n’en
retiendrait-on pour témoignage que sa conception de l’abbaye de Thélème
inspirée du château de Bonivet, construit dans le nouveau style italien
de la Renaissance, et la mention dans son Pantagruel, du traité de Battista Alberti, le « De re aedificatoria », et de celui de Vitruve « De architectura » !
C’est avoir trouvé ces monuments dignes des plus grands éloges, les
avoir jugés œuvre parfaite, que d’en attribuer la construction à
Pantagruel ; car son héros, déjà dans ce premier livre, ne fait rien de
vulgaire. Toutes ses actions, pour si fantaisistes soient-elles,
procèdent d’une surprenante sagesse, et dans le Tiers lIvre, il
apparaîtra comme un personnage intelligent et bon, doué d’une étonnante
sérénité d’esprit, un de homme de « bon sens et discret jugement et
admirable doctrine », essentiellement raisonnable, ne s’étonnant de
rien, ignorant les vains tourments, ne se scandalisant jamais. Tout
autant d’heureuses dispositions d’esprit et de caractère qui révèlent sa
force d’âme, sa fermeté et sa bravoure et font de lui un exemplaire
supérieur d’humanité, comme le note très justement l’auteur de la plus
récente étude sur l’œuvre rabelaisienne[5].
Dans les multiples chapitres de ses quatre volumes, Rabelais mettra, à
l’actif de Pantagruel, d’innombrables entreprises : il sera juge avisé
et équitable, dialecticien adroit, philologue, pourfendeur de géants,
intrépide buveur, déchiffreur d’énigmes, navigateur, chasseur de monstre
marin, expert en toutes choses, habile à se tirer des plus
extraordinaires aventures, et que sais-je encore, mais il ne sera
bâtisseur qu’une seule fois pour débuter dans ce cycle étonnant de faits
héroïques et ce sera pour édifier en un tournemain les Arênes de Nimes
et le Pont-du-Gard. C’est donc qu’ayant admiré ces monuments, Rabelais a
considéré que c’était leur faire honneur que les attribuer à ce
surhomme que son imagination venait de créer, et ceux-là seulement parce
qu’à ces yeux et à son jugement ils représentaient entre tous une œuvre
parfaite, «plus divine que humaine »,
proclame-t-il. Jamais peut-être, bien que bref, plus complet tribut
d’admiration ne faut payé à ces surprenants vestiges de la civilisations
gallo-romaine qu’en ces quatre mots tombés de la plume de Rabelais.
Il
est dommage que Rabelais n’ait pu avoir, des Arênes, la vue d’ensemble
que nous en avons aujourd’hui, extérieurement et intérieurement, et qui
permet d’en saisir pleinement la majestueuse harmonie. Au XVIe siècle,
on le sait, elles étaient enserrées par des maison, pour la plupart
délabrées, dont certaines faisaient corps avec ses arcades et parcelles
construites à l’intérieur de son enceinte. Si, malgré ce, Rabelais les
jugea avec l’admiration que l’on sait, ce fut certainement qu’il put,
au cours d’un examen attentif, se pénétrer des moindres détails de la
technique architecturale qui avait présidé à leur construction, mettant à
profit ses connaissances acquises à la lecture de Vitruve et d’Alberti.
Par contre, il put admirer le Pont-du-Gard, tel ou presque tel que les
romains l’avaient construit, indemne de toute adjonction parasitaire
avec, cependant du côté Nord-Est, ses piliers entaillés à la hauteur du
premier étage pour livrer passage aux piétons et aux bêtes de somme. Tel
était bien, en effet, son état
au XVIe siècle, comme l’écrivit Poldo d’Albenas en 1560, dans son
Discours de l’antiquité à de Nismes : « Il sert à présent de Pont,
dit-il, principalement le premier étage, lequel a esté entrecoupé et les
pilastres tous eberchez d’un costé, tellement qu’un mulet peut y passer
tout chargé. Et ce a esté fait pour la commodité des gens du païs.»
Nul
doute que cette visite à Nime n’ai accru chez Rabelais son goût pour
l’antiquité. La connaissance des monuments romains du Sud-Ouest de la
France, celle des Arênes de Nimes, de la Maison-Carrée et du
Pont-du-Gard, ne firent qu’aviver son désir de voir Rome et ses vestiges
des anciens âges. Un voyage en Italie et la visite de Rome, c’était
« ce que je souhaitais le plus, dira-t-il un peu plus tard depuis que
j’aie eue quelque sens des belles lettres »[6]. Ce souhait, l’occasion de le réaliser allait se présenter.
En
1534 se trouvait à Lyon, se disposant à partir pour Rome, l’évêque de
Paris, Jean du Bellay, un fin diplomate en grand crédit auprès du roi.
Il se rendait à la Cour pontificale pour remplir une délicate mission.
Désireux de s’assurer, dans sa lutte contre Charles-Quint, les bons
offices de Henri VIII d’Angleterre, François Ier avait résolu
d’intervenir en faveur de ce monarque dans sa querelle avec le
Saint-Siège au sujet de l’annulation de son mariage avec Catherine
d’Aragon qu’il poursuivait dans le dessein d’épouser Anne de Boleyn.
Jean du Bellay fut donc prié par le roi d’aller plaider la cause de
Henri VIII auprès du pape, tâche difficile dans laquelle il devait
échouer. Pendant son arrêt à Lyon, il s’enquit d’un médecin pour
l’attacher à sa personne. On lui présenta Rabelais, il lui plût et
l’emmena avec lui. Le séjour à Rome dura un peu plus de deux mois, qui
furent mis à profit par Rabelais pour étudier les drogues et les plantes
médicinales usitées en Italie, mais aussi pour satisfaire ses goûts
archéologiques. A ce dernier point de vue, il avait devant lui un champ
d’études d’une richesse incomparable, malgré les dévastations qu’avaient
fait subir aux monuments antiques les initiatives de Bramante, le Ruinante,
comme on le surnomma, dans sa réalisation des conceptions urbanistes du
pape Jules II et les entreprises de Léon X. Il restait encore très
ample matière à explorer, et puis, que de vestiges enfouis qui,
journellement, revoyaient le jour sous la pioche des terrassiers. Dès
son arrivée, Jean du Bellay avait fait l’acquisition, dans le quartier
Saint-Laurent in Palisperna, dans le val qui séparait le Quirinal du
Viminal, d’une maison de campagne avec prairies et verger, une
« vigne », comme on disait alors. Dans ces terrains, Rabelais entreprit
des fouilles en compagnie de deux autres personnages de la suite de
l’évêque, Claude Chapuis, l’un des bibliothécaires de François Ier, et
Nicolas Leroy, un jurisconsulte tourangeau, fouilles qui furent
couronnées de succès et vinrent enrichir les collections de cet homme de
goût qu’était l’évêque de Paris. Encouragé par les résultats obtenus,
Rabelais conçut le projet de dresser une topographie de la Rome antique
en s’aidant des anciens textes et de la visite de ces monuments, mais il
dut renoncer bientôt à sa réalisation devant une entreprise similaire
déjà poussée assez avant par le milanais Marliani. Lorsque parut
l’ouvrage de cet archéologue, la Topographia antiquae Romae,
Rabelais en publia à Lyon, en 1534, chez Gryphe, une édition en tête de
laquelle il plaça une épître dédicatoire adressée à Jean du Bellay, dans
laquelle il rappelait ses travaux poursuivis à ses côtés, et parfois en
collaboration avec lui, durant leur séjour à Rome : «Personne,
écrivait-il, ne connaît mieux sa propre demeure, je pense, que je
connais Rome et toutes les ruelles de Rome. Et vous, quand vous aviez un
peu de temps libre dans cette célèbre et difficile ambassade, vous
l’usiez à visiter les monuments de la ville. Et il ne vous suffisait pas
de voir ceux qui sont exposés aux regards, vous vous occupiez d’en
faire sortir du sol, après avoir acheté à cet effet une vigne assez
belle. C’est pourquoi…, pour qu’il me restât quelque fruit de mes
études, j’abordai la topographie de Rome… » Et ce travail, qu’il avait
ainsi entrepris, n’avait pas été improvisé, tant s’en faut. En effet,
dans cette même épître dédicatoire, Rabelais rappelle qu’il s’y était
préparé de longue date : » Bien avant que nous fussions à Rome,
écrivait-il, je m’étais fait une idée en mon esprit et intelligence de
ces choses dont le désir m’avait attiré là. J’avais décidé de visiter
d’abord les hommes doctes qui auraient quelque réputation dans les lieux
où nous passerions, de conférer familièrement avec eux et de les
entendre touchant quelques problèmes délicats qui depuis longtemps me
tenaient dans l’inquiétude… Pour cela, j’avais apporté avec moi un
fatras de notes prises dans divers auteurs des deux langues. » Ces
choses, qu’il désirait étudier de près, c’étaient sans doute la flore
médicinale et les drogues en usage dans le pays ; mais, -il le dit
clairement- c’étaient aussi les antiquités romaines. Des unes et des
autres il s’était fait une idée. Et l’on peut dès lors tenir pour
certain que, des secondes, cette idée s’est précisée en son esprit au
cours de ses voyages dans le Midi de la France, et qu’aux notions qu’il
en avait ainsi acquises, les monuments romains de Nimes n’étaient pas
étrangers
Trois
mois après, au moment de la foire de Novembre 1534, Rabelais publia son
Gargantua : puis, en Juillet 1535, il repartit pour Rome, accompagnant à
nouveau Jean du Bellay qui venait d’être nommé cardinal et faisait sa
visite ad limina au nouveau pape Paul III, dont il avait facilité
l’élection en décidant les cardinaux français à voter pour lui. Pendant
ce second séjour à Rome, qui dura sept mois, Rabelais tout en s’occupant
activement à se faire pardonner par le Saint Père son apostasie, - ce à
quoi il réussit – ne manqua pas de poursuivre ses études des monuments
antiques. Aux Français de passage il se plaisait à les expliquer. C’est
ainsi qu’il va les faire visiter à Thevet, le cosmographe de François
Ier, et à Philibert Delorme, alors une jeune adolescent dont, néanmoins ,
les connaissances archéologiques et architecturales étaient surprenantes. Rentré à Lyon, il en partit presqu’aussitôt
pour Paris, où il assista, en Mars, au banquet d’Etienne Dolet, qui
accusé du meurtre du peintre Guillaume Compaing qui lui avait cherché
querelle, venait d’être gracié par le roi. Un mois après, il était à
Montpellier où, le 3 Avril, il payait les droits de diplôme de licencié,
et le 22 Mai était reçu docteur en médecine. Nouveau retour à Lyon pour
peu de temps, car à la fin de l’année 1537, le voilà de retour à
Montpellier, professant à la Faculté sur les Pronostics d’Hippocrate commentés d’après le texte grec.
Qu’il
soit venu à Nîmes, après ce troisième séjour à Montpellier, la chose
n’est pas impossible. Ce qui est certain, c’est que les 14, 15 et 16
juillet 1538, il se trouvait à Aiguesmortes à l’entrevue de François Ier
et de Charles-Quint. Le fait est noté dans une lettre du lieutenant de
la sénéchaussée de Provence, Antoine Arlier, adressée à Etienne Dolet.
Antoine Arlier était un Nimois féru d’humanisme, docteur de l’Université
de Padoue, savant, après un long séjour en Italie, tout ce qu’on
pouvait savoir des lettres, sciences, jurisprudence et arts de ce pays.
Revenu dans sa ville natale, il avait, en 1533, brossé lui-même les
décors et composé les emblèmes et devises des arcs de triomphe élevés
pour l’entrée à Nimes de François Ier. En 1535, il avait été nommé
premier consul de la ville, et le corps municipal l’avait député auprès
du roi pour u roffrir une reproduction en argent des Arênes. Peu après,
il était pourvu de l’office de lieutenant du Sénéchat de Provence au
siège d’Arles. Lorsqu’il fut décidé que François Ier et Charles-Quint se
rencontreraient à Aigues-Mortes, le connétable de Montmorency chargea
Antoine Arlier, en sa qualité d’administrateur du territoire sur lequel
l’entrevue devait avoir lieu, d’aménager la salle dans laquelle le Roi
de France recevrait l’Empereur. Sur le point de partir pour accomplir sa
tâche, Arlier reçut d’Etienne Dolet un recueil de vers qu’il venait de
faire paraître. Après l’entrevue des deux souverains, il s’empressa de
remercier Etienne Dolet de son envoi et, dans sa lettre annonçant le
retour de François Ier à Lyon, il cite Rabelais comme faisant partie des
personnages de la suite du roi.[7] Or
d’Aiguesmortes, le 16 juillet 1538, Rabelais se trouva à Nîmes. Sans
doute en profita-t-il pour revoir les monuments romains. S’il eut le
loisir de le faire, il lui fut alors donné de voir la Maison-Carrée et
les Arênes sous un aspect différent de celui qui déjà, en 1532, avait
provoqué son admiration, car, exécutant les ordres donnés par le roi
lors de sa venue à Nimes en 1533, on avait commencé la démolition des
maisons délabrées masquant ces deux monuments, notamment de celles
aménagées sous le portique supérieur des Arênes.
Puis
le temps passa, et bien des années après – sa mort était alors
prochaine – Rabelais témoigna encore de son penchant pour les vestiges
des anciennes civilisations qu’il avait tant admirés. Dans
son « Quart-Livre » en effet, paru en 1552, il conduit Pantagruel et ses
compagnons, au cours de leurs navigations à la recherche de l’oracle de
la Dive Bouteille, dans l’île imaginaire des Mécréons où il leur fait
admirer « plusieurs vieulx temples ruinés, plusieurs obélisces,
pyramides, monuments et sépulchres antiques avecques inscriptions et
épitaphes divers, les uns en lettres hiéroglyphiques, les aultres en
languaige ionicque, les aultres en langues arabicques, agarène,
sclavonicque et aultres »[8] ? C’est là un souvenir donné à son passé d’archéologue et d’épigraphiste.
Après
tout cela, c’est-il pas permis de penser que les antiquités romaines de
Nimes, et de sa région ont eu leur part d’influence sur la formation
intellectuelle de Rabelais, contribuant ainsi à parfaire les idées et
les goûts qui ont fait de lui, en France, un , des meilleurs pionniers
de la Renaissance, celui que Chateaubriand n’hésita pas à conidérer
comme le « créateur des lettres françaises ».[9]
[1]> - À cet égard voir la Vie de Rabelais de J. Plattard
[2] Pantagruel . Chapitre V
[3] J. Lattard. – Vie de Rabelais
[4] Causerie du lundi – tome XII
[5] Lote : La vie et l’œuvre de Rabelais
[6] Lettre dédicatoire à Jean-du-Bellay
[7] Voir
à ce sujet : Revue des Etudes rabelaisiennes (tome III, 1905), article
de M. Picot. Rabelais à l’entrevue d’Aiguesmortes (juillet 1538)
[8] Qyart-Livre chapitre XXV
[9] Chateaubriand – Mémoires d’Outre-Tombe (édition Biré) Tome II, page 192.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire